Distinguer la réalité de la fiction
Bien que bon nombre de Canadiens, surtout les jeunes, entendent d’abord parler de l’actualité sur les médias sociaux, des recherches ont démontré que les vidéos des organes d’information sont rarement visionnées, laissant un vide que la désinformation (ou la désinformation intentionnelle) peut combler[1]. Et si les gens surestiment souvent la fréquence de la désinformation dans les actualités, cette perception peut également réduire la confiance dans les sources d’information fiables[2].
Trois types de nouvelles doivent être examinés attentivement :
- le contenu non réservé aux nouvelles, comme les publicités et les articles d’opinion, qui ressemble à des nouvelles;
- les nouvelles entièrement fausses, dont les satires et les histoires fausses qui prétendent être vraies;
- les nouvelles véritables qui sont considérablement compromises par le parti pris de la source.
Les recherches indiquent que la plupart des gens jugent une source de nouvelles en partie selon sa ressemblance à une nouvelle[3]. Il peut alors être difficile de faire la différence entre une véritable nouvelle et une « publicité indigène » ou du « contenu commandité » qui imite la forme des nouvelles : une étude a dévoilé que 82 % des élèves étaient en mesure de faire la différence entre une vraie nouvelle et une publicité adoptant un format similaire sur le même site Web[4]. Il faut aussi tenir compte de la ligne de plus en plus floue entre la nouvelle et l’opinion et la difficulté de faire une différence entre les deux, surtout dans des contextes virtuels : bien que les articles d’opinion dans les journaux imprimés soient généralement distincts des actualités, les recherches démontrent que moins de la moitié des organes de presse ne fournissent aucune mise en garde quant aux articles en ligne pour aider les lecteurs à déterminer s’ils lisent une nouvelle ou une opinion[5].
Le deuxième type de nouvelles, soit les nouvelles entièrement fausses diffusées par des sources peu fiables ou fictives, peut avoir un impact considérable de trois façons :
- lorsque l’information rejoint les consommateurs de nouvelles qui n’ont pas les connaissances générales nécessaires pour faire la différence entre le (vrai) Boston Globe et le (faux) Boston Tribune[6], surtout maintenant qu’il est relativement facile de créer un site Web d’allure professionnelle;
- lorsque l’information rejoint des personnes qui sont susceptibles d’adopter un raisonnement motivé, c’est-à-dire l’habitude mentale de procéder à l’envers à partir de ce qu’elles croient être leur jugement de la crédibilité d’une source, laquelle est associée à l’adoption de croyances fortement polarisées sur le sujet[7]
- lorsque des nouvelles fausses ou considérablement déformées passent de sources peu fiables aux sources de nouvelles légitimes. La distinction floue entre les faits et les opinions décrite ci‑dessus, en plus de l’adaptation du contenu des nouvelles pour des publics plus restreints, peut rendre les sources d’information vulnérables à leur propre forme de raisonnement motivé dans le cadre duquel elles sont davantage disposées à accorder le bénéfice du doute aux récits qui s’harmonisent avec leurs partis pris ou opinions politiques (ou ceux de leurs lecteurs ou téléspectateurs)[8].
Ce troisième type de nouvelles pourrait avoir le plus grand impact puisque, bien que les nouvelles entièrement fausses soient les plus évidentes, nous avons presque tous un ami ou un parent qui a partagé une histoire provenant du site The Onion ou The Beaverton sans réaliser qu’il s’agissait d’une satire, ou encore qui a vu des histoires inventées circuler pendant une élection, et c’est souvent lorsqu’elles se propagent jusqu’à une source légitime mais compromise qu’elles atteignent les consommateurs de nouvelles.
Aussi, il est difficile de reconnaître comment les partis pris influencent une source puisque toutes les sources ont un parti pris ou un autre et que certains partis pris sont plus difficiles à détecter puisqu’ils déterminent le contenu qui n’est pas inclus. Comme l’a dit Margaret Gallagher : « Le choix des personnes et du contenu à présenter dans l’actualité et la façon dont les gens et les événements sont représentés sont d’une importance cruciale. Aussi, les personnes et le contenu qui sont exclus sont également importants[9]. » Bien que les femmes représentent maintenant 41 % des journalistes dans les médias d’information canadiens, elles font l’objet de reportages dans seulement 31 % des cas[10]. La même étude a montré que l’invisibilité relative des femmes dans les médias d’information traditionnels à l’échelle mondiale a rejoint les plateformes virtuelles de diffusion de nouvelles. Seulement 21 % des personnes faisant l’objet de nouvelles sur Internet et dans les messages d’information sont des femmes[11]. De même, les trois quarts (75,5 %) des journalistes canadiens s’identifient comme personnes blanches, alors que ce n’est le cas que des deux tiers (68,8 %) de l’ensemble de la population[12]. Les membres des groupes marginalisés peuvent également avoir de bonnes raisons de ne pas faire confiance aux médias grand public puisqu’ils sont depuis longtemps marginalisés et stéréotypés par les médias d’information : par exemple, une étude a montré que les Afro-Américains considèrent que la couverture médiatique des personnes noires est excessivement négative, sélective et stéréotypée[13].
Bien que les partis pris soient largement considérés comme une raison de se méfier d’une source[14], les consommateurs risquent de se servir du fait que toutes les sources d’information sont au moins en partie biaisées pour rejeter toutes les sources sauf celles desquelles ils acceptent les partis pris[15]. Certains chercheurs ont découvert que cette habitude a produit des ensembles de « faits » divergents et des interprétations contradictoires de ces faits, accentuant le désaccord grandissant concernant des questions clés et semant l’incertitude sur ce que sont les opinions et ce que sont les faits[16]. De même, cela pourrait expliquer pourquoi une majorité d’Américains sont d’accord pour dire que les « fausses nouvelles » peuvent parfois (51 %) ou toujours (28 %) renvoyer à des nouvelles qui sont vraies, mais qui présentent le sujet sous un mauvais jour, et pourquoi ils estiment qu’il existe à la fois un trop grand nombre de sources d’information et un nombre insuffisant d’entre elles pour surmonter leurs partis pris[17]. C’est peut-être le résultat d’un parti pris hostile des médias, qui amène souvent les personnes des deux côtés d’une question à considérer que la couverture médiatique est biaisée à la défaveur de leur camp[18].
Pour corriger cette mauvaise interprétation de ce que sont les partis pris, nous devrions encourager les consommateurs à ne pas rejeter les partis pris, mais plutôt à comprendre les nouvelles dans leur contexte, les motivations et les intérêts (quels qu’ils soient) liés à la production de nouvelles, et la façon dont les nouvelles sont liées aux autres idées[19]. Plutôt que d’écarter une source dont le parti pris ne concorde pas avec le nôtre, un meilleur gage de fiabilité serait de déterminer si le parti pris compromet sa couverture de l’actualité (par exemple, en étant moins sceptiques face aux histoires qui appuient le parti pris ou en ignorant les reportages qui ne l’appuient pas) et d’examiner quelles mesures doivent être prises pour reconnaître et atténuer ce parti pris.
Les principaux signes indiquant qu’un organe de presse prend les mesures nécessaires sont les suivants :
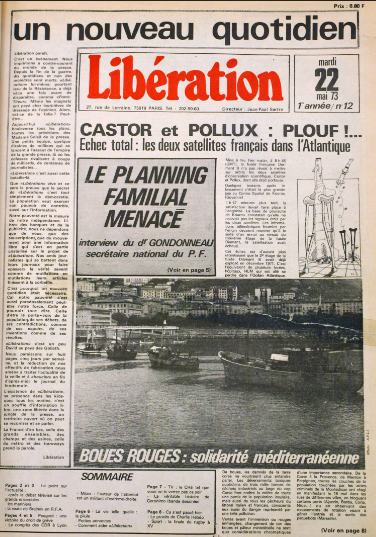
- le site fait preuve d’un souci d’exactitude. Bien que chaque organe de presse puisse parfois faire des erreurs, les erreurs fréquentes peuvent laisser supposer que l’exactitude n’est pas une grande priorité pour lui; (Esquiver la question en rapportant des nouvelles inexactes propagées par d’autres organes fait également partie de cette catégorie.)
- Il peut être utile de consulter la page d’accueil ou principale d’un média, ainsi que les pages d’opinion, pour avoir une idée de la proposition de valeur qu’il offre à son public : vous propose-t-il des informations exactes, divertissantes ou qui renforcent votre identité et vos croyances[20]?
- le site se rétracte et corrige les erreurs. Fait tout aussi important, lorsqu’un organe de presse fait une erreur, il devrait être honnête à cet égard et la corriger;
- le site suit une nouvelle, qu’elle appuie ou non elle les positions ou partis pris politiques. Les nouvelles et les éditoriaux (dans lesquels le conseil éditorial publie une opinion ou une analyse) devraient être distincts : le fait de ne pas couvrir les nouvelles qui sont en contradiction avec sa position ou de se concentrer davantage sur les nouvelles qui les appuient démontre que les partis pris influencent la couverture de l’actualité;
- le site cherche et présente des opinions différentes. Les organes de presse ne sont pas obligés d’accentuer la haine, le harcèlement ou la pseudo-science, mais en général, ils devraient s’assurer que tous les aspects d’une question sont représentés[21].
Les organes de presse peuvent prendre des mesures afin d’être davantage transparents dans le cadre de leur couverture de l’actualité :
- reconnaître ouvertement leurs points de vue et leurs possibles partis pris, et inclure non seulement les faits connus d’une histoire, mais aussi ceux qui ne le sont pas, afin d’aider les consommateurs à faire la différence entre les lacunes véritables et les éléments qui ont été délibérément mis de côté;
- faire un lien avec les sources originales, dans la mesure du possible, comme les transcriptions et les bases de données, afin que les consommateurs puissent vérifier l’exactitude des renseignements qui sont présentés[22].
- Certains organes de presse publient leurs normes éditoriales ou leur code de conduite, vous permettant ainsi de connaître les mesures qu’ils prennent pour s’assurer de l’exactitude de ce qu’ils rapportent. Par exemple, le Globe and Mail publie son code de conduite éditorial sur son site Web, ainsi qu’une rubrique régulière rédigée par sa rédactrice en chef chargée des normes qui explique des sujets comme sa politique de correction et les raisons pour lesquelles il choisit des phrases ou des mots différents lorsqu’il couvre des questions particulières.
En outre, les médias peuvent prendre des mesures pour rendre leur couverture plus représentative, notamment :
- éviter les mots ou les phrases qui reflètent la position d’un groupe ou d’un autre;
- interviewer et citer des membres de groupes marginalisés concernés par le sujet;
- réfléchir à la manière dont différents groupes interprètent le cadrage et le titre de l’article;
- éviter le cadre de la « course à chevaux » ou du « combat existentiel[23]».
[1] Hagar, N., & Diakopoulos, N. (2023). Algorithmic indifference: The dearth of news recommendations on TikTok. New Media & Society, 14614448231192964.
[2] van der Meer, T. G., & Hameleers, M. (2024). Perceptions of misinformation salience: a cross-country comparison of estimations of misinformation prevalence and third-person perceptions. Information, Communication & Society, 1-22.
[3] Chakradhar, S. (2022) People mistrustful of news make snap judgments to size up outlets. Nieman Lab.
[4] Wineburg, Sam, Sarah McGrew, Joel Breakstone and Teresa Ortega. (2016). Evaluating Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning. Stanford Digital Repository.
[5] Iannucci, Rebecca. « News or Opinion? Online, It’s Hard to Tell. » Poynter.org, 16 aout 2017.
[6] Stecula, Dominik. « The Real Consequences of Fake News. » The Conversation Canada, 27 juillet 2017.
[7] Kahan, Dan. « What is Motivated Reasoning and How Does it Work? » Science and Religion Today, 4 mai 2011.
[8] Rimer, Sara. « Fake News Influences Real News. » BU Today, June 22 2017.
[9] « Who Makes the News: Global Media Monitoring Project. » World Association for Christian Communication, 2015.
[10] « Who Makes the News: Global Media Monitoring Project. » World Association for Christian Communication, 2021.
[11] « Who Makes the News: Global Media Monitoring Project. » World Association for Christian Communication, 2015.
[12] (2023) Canadian Newsroom Diversity Survey: Final Report. Canadian Association of Journalists.
[13] (2023) Black Americans’ Experiences with News. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/journalism/2023/09/26/black-americans-experiences-with-news/
[14] Newman, Nic and Richard Fletcher. Bias, Bullshit and Lies: Audience Perspectives on Low Trust and Media. Reuters Institute for the Study of Journalism, 2017.
[15] Kavanagh, Janet and Michael D. Rich. « Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life. » RAND Corporation, 2018.
[16] Kavanagh, Janet and Michael D. Rich. « Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life. » RAND Corporation, 2018.
[17] « American Views: Trust, Media and Democracy. » Knight Foundation, January 2018.
[18] Hansen, G. J., & Kim, H. (2011). Is the media biased against me? A meta-analysis of the hostile media effect research. Communication Research Reports, 28(2), 169-179.
[19] Malik, Momin, Sandra Cortesi and Urs Gasser. « The Challenges of Defining ‘News Literacy.’ » Berkman Center for Internet & Society, 2013.
[20] Hopkins, D. J., Lelkes, Y., & Wolken, S. (2024). The rise of and demand for identity‐oriented media coverage. American Journal of Political Science.
[21] Schudson, Michael. « Here’s What Non-Fake News Looks Like. » Columbia Journal Review, 23 février 2017.
[22] Rosen, Jay. « Show Your Work: The New Terms for Trust in Journalism. » PressThink, 31 décembre 2017.
[23] (2023) Anti-polarization checklist. Trusting News.
